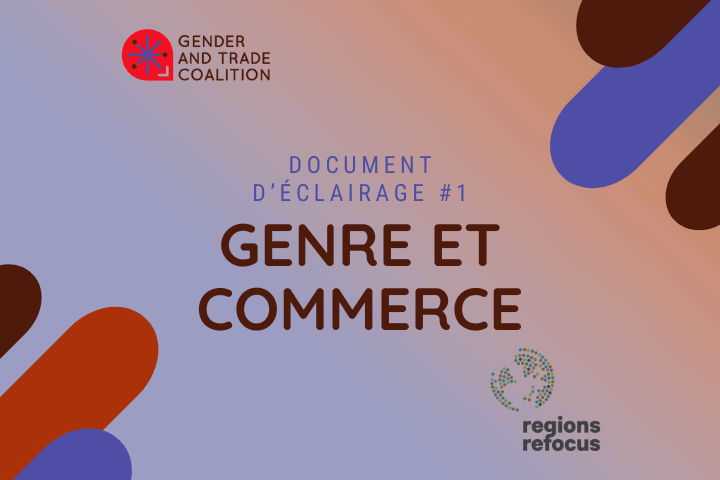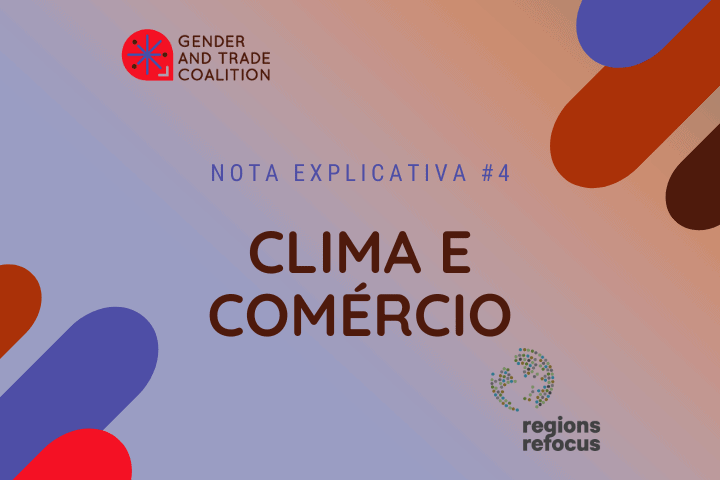À la base de l’économie globale moderne se trouve un éventail de règles de commerce et d’investissement conçues par les élites et les sociétés des pays développés. Ces règles interdépendantes renforcent les impacts des autres sur les économies nationales, permis par les institutions financières et commerciales internationales telles que la Banque mondiale, le Fonds monétaire international (FMI) et l’Organisation mondiale du commerce (OMC) qui servent de mécanismes d’application. De l’aggravation des violations des droits humains à la dégradation de l’environnement, les effets des régimes de commerce et d’investissement ont des répercussions sur tous les aspects de la vie des femmes, exacerbant et créant des inégalités qui se fondent sur la hiérarchisation de classe, de race, d’appartenance ethnique, d’orientation sexuelle et d’identité de genre.
En coulisses des scènes où s’élaborent les politiques économiques globales, les sociétés et le secteur financier composent le menu politique : libéralisation, dérégulation et privatisation. Travers à des conditions de prêts abusifs, des accords commerciaux et d’autres pratiques, les institutions financières et commerciales internationales ont appliqué ces politiques, créant à des « environnements propices » aux investissements étrangers. Les tarifs douaniers ont été abaissés ; les contrôles et possibilités d’investissement ont été libéralisés ; et les réglementations sur le secteur financier, les marchés et les sociétés ont été démantelées alors que les droits (en particulier la propriété intellectuelle) des sociétés ont été augmentés.1 Les multinationales et leurs filiales font du dumping d’importations à bas prix, la dépendance à l’exportation des denrées primaires est entretenue, les biens et services publics sont privatisés et les protections sociales sont amputées, entre autres choses.2 Tels sont les effets des politiques néolibérales « réussies », en particulier la libéralisation du commerce.
Les régimes de gouvernance des investissements et du commerce profondément inégalitaires se manifestent par l’aggravation des taux de pauvreté et des inégalités de genre ; par le creusement des écarts entre les pays les plus pauvres et les plus riches et entre les personnes les plus pauvres et les plus riches ; et par les effets néfastes sur des droits humains que l’on retenait pourtant inaliénables, notamment l’accès à l’éducation, au logement sûr, à la sécurité alimentaire et aux soins de santé.3 De plus en plus souvent, ce sont les populations des pays en voie de développement, et tout particulièrement les femmes, qui se retrouvent à endurer les répercussions graves des règles de commerce et d’investissement.4
L’intensification du commerce contemporain, son expansion et sa privatisation au sein de l’économie mondiale moderne reposent sur l’exploitation systématique des femmes. Les femmes constituent la colonne vertébrale de l’économie, du point de vue de la production comme du travail de soins : les femmes sont systématiquement sous-payées, ségréguées professionnellement, marginalisées et leur travail de soins est invisibilisé et dévalué. Les inégalités de genre ne sont pas le fruit du hasard, elles s’avèrent nécessaires au fonctionnement actuel de l’économie, en particulier du commerce. La perspective féministe appliquée à une analyse critique du commerce démontre la nécessité urgente de reconnaître le rôle crucial joué par les inégalités de genre dans le maintien des économies globales et nationales et met en lumière les domaines clés qui servent comme des opportunités d’interventions politiques.
Ces dernières années, les experts en politiques des grandes institutions financières et commerciales internationales (en particulier la Banque mondiale, le FMI et l’OMC) ont commencé à s’intéresser de plus en plus aux impacts genrés du commerce. Leur promesse était que la libéralisation du commerce entraînerait l'égalité des genres et l'émancipation des femmes: « le commerce permet d’augmenter le salaire des femmes et peut aider à réduire les inégalités économiques »5 ; « le commerce et l’investissement peuvent être des moteurs puissants de l’égalité des genres »6 ; « le commerce peut améliorer considérablement la vie des femmes ».7
Ces institutions financières et commerciales internationales dominantes s'engagent superficiellement avec le concept de l’égalité des genres et apparemment d’outil pour aligner leurs politiques sur le langage populaire. Dans leurs manuels de politique, aucun changement n’a été apporté en faveur de l’égalité des genres ; le genre a simplement été inséré dans la discussion : ils ont ajouté le genre et « remué ».8 Avec de petites différences entre eux la Banque mondiale, le FMI et l’OMC ont effectivement pinkwashé les politiques qu’ils préconisent : alors que la libéralisation du commerce est depuis longtemps le cœur de leur menu politique, c’est désormais l’émancipation des femmes servant de justification au lieu des bénéfices économiques.9
Dans leurs manuels de politique, aucun changement n’a été apporté en faveur de l’égalité des genres ; le genre a simplement été inséré dans la discussion : ils ont ajouté le genre
et « remué ».
Cela fait des décennies que les effets néfastes de la libéralisation du commerce sur les femmes ont été reconnus par les économistes et activistes féministes.10 Lors d’ateliers organisés par la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED) à Genève en 1999 et à la ville du Cap en 2001, l.es participant.es ont avancé des éléments montrant que « les femmes tendent à être plus vulnérables aux effets négatifs de la libéralisation du commerce, et moins en mesure de bénéficier de ses effets positifs ».11 En réaction aux efforts concertés de plaidoyer des féministes universitaires, activistes et spécialistes du développement, un nombre petit mais croissant des accords commerciaux ont commencé à mener des évaluations d’impact social (EIS) des activités liées au commerce.12
Une analyse des impacts sur le genre est habituellement incluse aux EIS, mais « des insuffisances dans la formulation, l’approche et la méthodologie ont » provoqué de sévères critiques de la validité de ces évaluations.13 De plus, les EIS sont majoritairement effectuées avant l’entrée en vigueur d’un accord commercial, et une fois l’accord conclu, les pays essentiellement se lavent les mains des questions d’égalité de genre.14 D’autre part, les évaluations des accords commerciaux sous l’angle des droits humains ont également été fortement critiquées pour leur analyse inadéquate du genre.15
Plus inquiétant encore, l’égalité de genre a été utilisée comme examen de passage de la libéralisation du commerce. Pour « prouver » les impacts positifs sur le genre de la libéralisation du commerce, le chiffre le plus souvent cité est le taux de participation des femmes sur le marché du travail, qui a tendance à augmenter suite à la libéralisation du commerce.16 Mais ce chiffre global n’est en aucun cas une représentation holistique de la réalité, encore moins de celle des femmes du Sud mondial. Même s'il est vrai que la libéralisation du commerce permet à un plus grand nombre de femmes de trouver un emploi (d'où l'augmentation du taux de participation des femmes sur le marché du travail), mettre l’accent sur des statistiques quantitatives plutôt que qualitatives masque la création d’emplois d’exploitation, dont la plupart se situent au bas des chaînes de valeur mondiales.17
La libéralisation du commerce a ouvert la voie à des changements structurels au sein des processus de production. Pendant que les gouvernements du Sud mondial se retrouvant de moins en moins impliqués dans la régulation des marchés du travail (à cause de conditions fixées dans les accords commerciaux et les prêts), les marchés du travail sont devenus des terrains de jeu de plus en plus inégaux. La majorité des industries manufacturières (dominées par les sociétés) ont concentré leur production dans le Sud mondial où elles ont à leur disposition constante une main d’œuvre bon marché constituée par des travailleurs.euses peu ou pas qualifié.e.s, principalement des femmes.18 Ces travailleur.euses constituent le bas de l’échelle des chaînes de valeur mondiales (CVM) complexes.
Dans les CVM, les parties d’un même produit sont souvent fabriquées dans différents pays, assemblées dans un autre, et le produit fini est vendu à un autre groupe de pays tout à fait différents. Les CVM représentent une part croissante du commerce international, du PIB mondial et des emplois ; le développement des CVM est à la fois un résultat et un objectif de la libéralisation du commerce. L’implantation des sièges de secteurs manufacturiers des CVM dans des pays en voie de développement est allée de pair avec la croissance des marchés du travail monopsones, au sein desquels les employeurs peuvent maintenir des salaires bas et des conditions médiocres, car les travailleurs.euses n’ont pratiquement pas d'autres emplois possibles.19
Selon la Banque mondiale, les CVM « augmentent les revenus, créent de meilleurs emplois et réduisent la pauvreté ».20 L’intégration aux CVM est souvent idéalisée comme catalysante de développement, censée apporter des avantages spéciaux pour la sécurité de l’emploi et l’indépendance financière des femmes. Toutefois, malgré l’intégration de la plupart des pays en voie de développement aux CVM, si les tendances actuelles se perpétuent, il faudra 108 ans pour parvenir à l’égalité des genres.21
Malgré l’intégration de la plupart des pays en voie de développement aux CVM, si les tendances actuelles se perpétuent, il faudra 108 ans pour parvenir à l’égalité des genres.
Les emplois pour les femmes au sein des CVM se concentrent dans des secteurs spécifiques (ex. : agriculture, textile) et sont généralement peu rémunérés, ce qui pousse les femmes à devoir chercher toujours plus de travail tout à la fois assurant leurs responsabilités de travail de soins. Elles sont affectées à des emplois dont les conditions de travail sont, au mieux, discutables et qui ne requièrent pas de formation intensive, de capacités techniques ou de compétences, tandis que les formations pour les postes d’encadrement, de gestion ou des mieux rémunérés sont prévues pour les hommes.22 Pour les femmes de milieux ruraux, il est particulièrement difficile de gagner un salaire suffisant pour assurer la sécurité alimentaire de leur foyer.23 Les femmes des milieux ruraux cumulent souvent des dettes pour répondre aux besoins de base de leurs familles ; les programmes de microfinancement prédateurs ciblent souvent ces femmes précisément.24
La ségrégation professionnelle a été fortement renforcée par les dispositions présentes dans les accords commerciaux, telles que l’établissement de zones économiques spéciales, qui attirent les investissements étrangers en « éliminant les obstacles aux activités commerciales » et facilitent l’exploitation et les violations des droits du travail d’une main-d’œuvre majoritairement féminine.25 Le processus de changements structurels du marché du travail aggravant les inégalités de genre, comme ce qui a lieu avec la libéralisation du commerce, est qualifié de féminisation du travail.26 Dans son expression actuelle, le commerce est incompatible avec le bien-être des femmes des pays en voie de développement, encore moins l’égalité de genre. Tout ceci est permis et justifié par les profits faits par les sociétés, bien que la plupart de ces profits soit réacheminé vers le Nord mondial.
L’implication grandissante des sociétés dans l’économie globale est un autre objectif central de l’agenda politique néolibéral. En procédant au démantèlement des barrières commerciales, les firmes multinationales (FMN) ont pu s’installer et évincer les producteurs et productrices locales. En l’absence de concurrence ou de réglementation, les FMN ont monopolisé des secteurs entiers et pris le contrôle de services publics tels que la santé, l’eau, l’éducation et l’électricité, sapant les priorités politiques nationales et les droits humains.27 Le projet de consolidation du pouvoir dans l’économie est indissociable de la libéralisation du commerce.
La libéralisation du commerce dans les pays en voie de développement signifie que les politiques ayant propulsé les pays désormais développés à leurs niveaux actuels de prospérité sont impossibles.28 Les multinationales sont invitées et la production réalisée par les entreprises nationales (autant de plus pour les petites entreprises) est rendue totalement impossible, même si la spécialisation nationale constituait l’une des principales stratégies de développement dans les pays désormais développés ; les tarifs douaniers sont démantelés en faveur du « libre-commerce », même si les tarifs représentaient une part significative des revenus de ces pays lorsqu’ils étaient des pays en voie de développement ; le « libre-commerce » n’est compatible qu’avec une industrialisation tournée vers les exportations, même si l’industrialisation de remplacement des importations a été utilisée par pratiquement tous les pays désormais développés ; la liste continue. La libéralisation du commerce veut dire que les enjeux sociaux sont relégués au second plan par rapport aux enjeux financiers, ce qui assoit les inégalités structurelles, en particulier les inégalités de genre.
La libéralisation du commerce veut dire que les enjeux sociaux sont relégués au second plan par rapport aux enjeux financiers, ce qui assoit les inégalités structurelles, en particulier les inégalités de genre.
Dans le cas de l’agriculture, par exemple, la libéralisation du commerce permet l’afflux de produits agricoles industriels (et donc moins chers) sur les marchés locaux, contre lesquels les petit.e.s agriculteurs.trices sont incapables de rivaliser, ce qui finit par les exclure du marché. Ceci crée des défis pour tout.e.s les petit.e.s agriculteurs.trices, mais à cause des barrières structurelles (ex. : accès au foncier, aux financements et aux technologies), les petites agricultrices femmes doivent relever de plus grands défis que leurs collègues masculins pour faire face à la concentration et à l’industrialisation de la production agricole. Un point de ralliement depuis des décennies est le dumping de volaille, venu perturber les marchés locaux et ayant un impact disproportionné sur les agricultrices femmes, qui constituent la majorité dans ce secteur.29
La mainmise des multinationales sur l’agriculture a également accéléré la dégradation environnementale et créé des problèmes de souveraineté alimentaire, en particulier chez les femmes. La tendance croissante aux monocultures et aux cultures commerciales a facilité l’industrialisation de l’agriculture, ce qui a entraîné une énorme aggravation de l’empreinte carbone du secteur en poussant les femmes agricultrices à la faillite de façon disproportionnée. La commercialisation intensive de semences hybrides et des intrants agricoles industriels auprès des communautés a un impact négatif sur l’autonomie des agriculteurs.trices dans les pratiques agricoles, et en particulier celle des femmes, car ce sont elles qui sont habituellement les gardiennes des semences locales. Ceci pousse à une criminalisation croissante de la constitution de banques de semences locales.30 À mesure que les droits des agriculteurs.trices locaux sont sapés et qu’ils et elles sont poussées à la faillite, les multinationales peuvent former des monopoles et mettre la mainmise sur le secteur. Ces processus sont un défi direct à la souveraineté alimentaire (contrôle sur ce qui est produit et sur le choix des aliments que nous consommons) et la commercialisation de grandes étendues de terre a des répercussions sérieuses sur la perte de biodiversité et l’effondrement écologique.
À la veille et au lendemain de la crise alimentaire de 2007-2008, les sociétés et gouvernements étrangers ont acheté 227 millions d’hectares de terres, dont la moitié en Afrique.31 Ce type d’accaparement de terres est la deuxième étape dans la mainmise des FMN et a généralement lieu une fois que les producteurs.trices locaux ont été expulsés du marché, facilitée par la libéralisation du commerce. L'inégalité structurelle est exacerbée par le fait que les femmes sont poussées de manière disproportionnée sur le marché du travail monopsonique, se retrouvant parfois à travailler pour ces mêmes multinationales qui les ont poussées à la faillite.
Les institutions financières et commerciales internationales dominantes situées dans le Nord mondial ne parviennent pas à répondre aux problèmes rencontrés par le Sud mondial. Alors que les femmes du Sud mondial travaillent dans des ateliers clandestins, gagnent des salaires de pauvreté et mettent en danger leur santé, tout en effectuant le travail de soins non rémunéré qui permet aux hommes de participer à l’économie, elles servent de soutènement aux CVM complexes qui valent des milliards de dollars.
Paradoxalement, la libéralisation du commerce a besoin des femmes, qu'elle exploite en tant que source de main-d'œuvre bon marché et jetable, alors qu'elle est présentée comme un outil d'autonomisation des femmes. Nombre de forums de commerce officiels se discutent désormais sur les composantes sociales des politiques commerciales et de la libéralisation du commerce ; pourtant, ce débat a lieu sans tenir compte des véritables nécessités, intérêts et limites des femmes. Pour avancer vers du commerce juste en termes de genre, il est crucial de :
- Inclure les organisations de droits des femmes lors des négociations des accords commerciaux et d’investissement. Les activistes et universitaires féministes ont facilité les progrès dans la compréhension des impacts du commerce spécifiques au genre, pourtant leurs analyses et leurs conseils sont aux mieux utilisés de façon symbolique ou en guise de quota et au pire ignorées (comme c'est le cas avec l’OMC).
- Changer d’angle analytique à la nature des emplois créés pour les femmes plutôt que simplement si des emplois seront créés ou non. Comme nous l’avons vu, l’hypothèse selon laquelle la libéralisation du commerce est intrinsèquement bénéfique aux femmes car elle « soulève tous les bateaux » ne se vérifie pas dans la pratique.32 Ce changement d’angle est suggéré depuis longtemps par les institutions internationales progressistes, comme la CNUCED.32 De plus, un vaste effort de collecte de données désagrégées et qualitatives aidera à combler le déficit de données sur le genre, un point inscrit de longue date à l’agenda des universitaires-activistes féministes.
- Donner aux politiques industrielles actives la place qui leur revient au sein des espaces politiques des pays en voie de développement, en subventionnant par exemple les industries nationales particulièrement axées sur l’égalité de genre. L’émancipation véritable des femmes est incompatible avec la libéralisation du commerce et toutes ses retombées, les femmes ne pourront voir d’amélioration de leur vie sans l’intervention gouvernementale dans la création d’emplois. L'adoption de politiques industrielles ciblées devrait permettre d'accroître la part des femmes et les avantages qu'elles retirent du commerce et des possibilités d'exportation qui respectent le droit à un travail décent.
- Mener des évaluations de l’impact social et sur les droits humains avant, périodiquement pendant et après la mise en œuvre des accords de commerce et d’investissement. Les évaluations doivent être menées par des expert.e.s indépendant.e.s de la société civile, en concertation avec les communautés touchées et contribuer aux processus de prise de décision participatifs. Les résultats de ces évaluations devront être présentés aux législateurs.trices avant toute ratification d’accord, et les résultats devront être utilisés pour éclairer les négociations et les politiques de commerce et d’investissement, y compris à l’échelle mondiale, pour atténuer leurs impacts délétères sur les femmes. Dans les cas où les évaluations périodiques identifient des impacts néfastes inattendus sur les droits humains et les droits sociaux, des mécanismes institutionnels devront être mis en place pour adapter les accords en temps réel et répondre aux inquiétudes soulevées par les évaluations.
- Restaurer la maîtrise nationale des moyens de production. Les gouvernements et en particulier ceux du Sud mondial doivent s’attaquer au problème grandissant de la privatisation et de la mainmise des multinationales sur l’agriculture, la pêche, les services publics et les ressources naturelles limitées telles que l’eau. C’est d’ailleurs d’autant plus urgent que les inégalités structurelles de genre en matière de sécurité et souveraineté alimentaires, d’accès à l’eau et d’assainissement, d’énergie, de travail de soins, de prestations sociales et sur le marché du travail menacent la survie des femmes face à une crise polymorphe qui inclut l’urgence climatique.
1 Aguirre, Eick et Reese 2006 ; Hathaway 2020 ; Hursh et Henderson 2011.
2 Hormeku-Ajei et coll. 2022.
3 HCDH 2015 ; Koechlin 2013 ; Navarro 2007 ; Western et coll. 2016.
4 Grzanka, Mann et Elliott 2016 ; CNUCED 2014 ; CNUCED et ONU Femmes 2020 ; Pearson 2019.
5 Rocha et Piermartini 2023, 49.
6 Banque mondiale 2019.
7 Banque mondiale 2020a.
8 Coburn 2019 ; Hannah, Roberts et Trommer 2021 ; Perrons 2005 ; Rao 2015 ; True et Parisi 2013.
9 Hannah, Roberts et Trommer 2021.
10 Voir par exemple Coburn 2019 ; Perrons 2005 ; Prügl 2017 ; Williams 2007, 2013.
11 Nordås 2003, 4.
12 Dommen 2021 ; Elson et Fontana 2018 ; Noble 2018.
13 Noble 2018, 15. Voir également Hannah, Roberts et Trommer 2021 ; Joekes, Frohmann et Fontana 2020.
14 Dommen 2021 ; Noble 2018.
15 Noble 2018.
16 Bárcia de Mattos et coll. 2022 ; Réseau interinstitutions pour l’égalité des genres 2011.
17 Réseau interinstitutions pour l’égalité des genres 2011.
18 Ibid.
19 Kölling 2022 ; Manning 2021 ; Naidu et Posner 2022.
20 Banque mondiale 2020b, 3.
21 Forum économique mondial 2018.
22 APWLD 2023 ; Bárcia de Mattos et coll. 2022.
23 APWLD 2023.
24 Karunakaran 2008 ; Mumtaz 2000 ; Ukanwa, Xiong et Anderson 2018.
25 Gebrewolde 2019, 6. Voir également Fontana 2009 ; HCDH 2019 ; Kennard et Provost 2016.
26 CNUCED 2014 ; Tran 2019.
27 Hathaway 2020 ; Holst 2023 ; van Elteren 2009.
28 Chang 2002.
29 Madibana, Fouche et Manyuela 2024 ; Narcisse 2010.
30 Gordon 2023.
31 Hodzi-Sibanda et Makaza-Kanyimo 2017 ; Yang et He 2021.
32 Hannah, Roberts et Trommer 2021, 4.
33 Voir par exemple CNUCED 2013, 2014 ; CNUCED et ONU Femmes 2020.
Aguirre, Adalberto ; Eick, Volker et Reese, Ellen. 2006. « Introduction: Neoliberal Globalization, Urban Privatization, and Resistance » (« Introduction : mondialisation néolibérale, privatisation urbaine et résistance »). Social Justice 33 (3) : 1–5.
Asia Pacific Forum on Women, Law, and Development (APWLD). 2023. « Strengthening Feminist Movements for Trade & Economic Justice » (« Renforcer les mouvements féministes pour le commerce et la justice économique »). Rapport de recherche-action régionale participative féministe, Women Interrogating Trade & Corporate Hegemony (WITCH).
Banque mondiale. 2019. « Trade & Gender Brief » (« Note d'information sur le commerce et le genre »).
Banque mondiale. 2020a. « Women and Trade: The Role of Trade in Promoting Gender Equality » (« Femmes et commerce : le rôle du commerce dans la promotion de l’égalité de genre »). Banque mondiale, 30 juillet 2020.
Banque mondiale. 2020b. « World Development Report 2020: Trading for Development in the Age of Global Value Chains » (« Rapport sur le développement dans le monde 2020 : Le commerce au service du développement à l’ère des chaînes de valeur mondiales »).
Bárcia de Mattos, Fernanda ; Esquivel, Valeria ; Kucera, David et Tejani, Sheba. 2022. « The State of the Apparel and Footwear Industry: Employment, Automation and Their Gender Dimensions » (« L'état de l'industrie de l'habillement et de la chaussure : emploi, automatisation et leurs dimensions de genre »). Construire des partenariats sur l'avenir du travail, document de référence no. 3, UE et OMC.
Chang, Ha-Joon. 2002. « Kicking Away the Ladder: Development Strategy in Historical Perspective » (« Le coup de pied dans l'échelle : la stratégie de développement dans une perspective historique »). Londres : Anthem Press.
Coburn, Elaine. 2019. « Trickle-down Gender at the International Monetary Fund: The Contradictions of ‘Femina Economica’ in Global Capitalist Governance » (« Le ruissellement de genre au Fonds monétaire international : les contradictions de la « Femina Economica » dans la gouvernance capitaliste mondiale »). International Feminist Journal of Politics 21 (5) : 768–788. https://doi.org/10.1080/14616742.2019.1607764.
CNUCED. 2013. « Why Trade Matters in Development Strategies » (« Pourquoi le commerce est important dans les stratégies de développement »). Rapport du forum de discussion.
CNUCED. 2014. « Virtual Institute Teaching Material on Trade and Gender Volume 1: Unfolding the links » (« Matériel pédagogique de l'Institut virtuel sur le commerce et le genre Volume 1 : Déployer les liens »).
CNUCED et ONU Femmes. 2020. « Assessing the Impact of Trade Agreements on Gender Equality: Canada-EU Comprehensive Economic and Trade Agreement » (« Évaluation de l’impact des accords commerciaux sur l’égalité des sexes : Accord économique et commercial global entre le Canada et l’UE »).
Dommen, Caroline. 2021. « Mainstreaming Gender in Trade Policy: Practice, evidence, and ways forward » (« Intégration de la dimension de genre dans la politique commerciale : pratiques, données probantes et pistes d’avenir »). International Institute for Sustainable Development (IISD).
Elson, Diane et Fontana, Marzia. 2018. « When It Comes to Gender Analysis, Modern Trade Agreements Are Lacking » (« En matière d’analyse de genre, les accords commerciaux modernes manquent de cohérence »). Centre for International Governance Innovation (CIGI), 4 avril 2018.
Fontana, Marzia. 2009. « Gender Justice in Trade Policy: The gender effects of Economic Partnership Agreements » (« Justice de genre dans la politique commerciale : les effets des accords de partenariat économique sur le genre »). One World Action.
Forum économique mondial. 2018. « The Global Gender Gap Report 2018 » (« Rapport mondial sur l'inégalité de genre 2018 »).
Gebrewolde, Tewodros Makonnen. 2019. « Special Economic Zones: Evidence and prerequisites for success » (« Zones économiques spéciales : preuves et conditions préalables à la réussite »). Note politique. International Growth Centre (IGC).
Gordon, Graham. 2023. « How the World Bank is restricting farmer’s rights to own, save, and sell seeds » (« Comment la Banque mondiale restreint les droits des agriculteurs à posséder, conserver et vendre des semences »). Institute of Development Studies (IDS), 24 juillet 2023.
Grzanka, Patrick R. ; Mann, Emily S. et Elliott, Sinikka. 2016. « The Neoliberalism Wars, or Notes on the Persistence of Neoliberalism » (« Les guerres du néolibéralisme, ou notes sur la persistance du néolibéralisme »). Sexuality Research and Social Policy 13 (4) : 297–307. https://doi.org/10.1007/s13178-016-0255-8.
Hannah, Erin ; Roberts, Adrienne et Trommer, Silke. 2021. « Towards a feminist global trade politics » (« Vers une politique commerciale mondiale féministe »). Globalizations 18 (1) : 70–85. https://doi.org/10.1080/14747731.2020.1779966.
Hathaway, Terry. 2020. « Neoliberalism as Corporate Power » (« Le néolibéralisme comme pouvoir des sociétés »). Competition & Change 24 (3–4) : 315–337. https://doi.org/10.1177/1024529420910382.
Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme (HCDH). 2015. « UN experts voice concern over adverse impact of free trade and investment agreements on human rights » (« Des experts de l'ONU s'inquiètent des effets négatifs des accords de libre-échange et d'investissement sur les droits de l'homme »). Communiqué de presse.
HCDH. 2019. « UN human rights experts raise alarm about the situation of Indian migrant workers in Gabon Special Economic Zone » (« Des experts des droits de l'homme de l'ONU s'alarment de la situation des travailleurs migrants indiens dans la zone économique spéciale du Gabon »). Communiqué de presse.
Hodzi-Sibanda, Charity et Makaza-Kanyimo, Dorcas. 2017. « Advocating for the Forgotten: Land Grabs and their Impact and Implications for Women in Zimbabwe and Mozambique » (« Plaidoyer pour les oubliés : les accaparements des terres et leurs conséquences pour les femmes au Zimbabwe et au Mozambique »). Global Greengrants Fund.
Holst, Jens. 2023. « Viral Neoliberalism: The Road to Herd Immunity Still A Rocky One ». (« Néolibéralisme viral : la route vers l’immunité collective reste semée d’embûches »). International Journal of Social Determinants of Health and Health Services 53 (1) : 30-38. https://doi.org/10.1177/00207314221131214.
Hormeku-Ajei, Tetteh ; Balaji, Aishu ; Olukoshi, Adebayo et Nayar, Anita. 2022. « Introduction: Early Post-Independence Progressive Policies– Insights for our Times » (« Introduction : Les politiques progressistes de l’après-indépendance – Perspectives pour notre époque »). Africa Development 47 (1) : 159–191. https://doi.org/10.57054/ad.v47i1.
Hursh, David W. et Henderson, Joseph A. 2011. « Contesting Global Neoliberalism and Creating Alternative Futures » (« Contester le néolibéralisme mondial et créer des futurs alternatifs »). Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education 32 (2): 171–185. https://doi.org/10.1080/01596306.2011.562665.
Joekes, Susan ; Frohmann, Alicia et Fontana, Marzia. 2020. « A Primer on Gender and Trade » (« Un guide sur le genre et le commerce »). Série de produits de connaissances sur le genre, l'inclusion sociale et le commerce, BKP Economic Advisors.
Karunakaran, Kalpana. 2008. « The Vulnerability of ‘Self-Help’: Women and Microfinance in South India » (« La vulnérabilité du « Self-Help » (aide propre) : les femmes et la microfinance en Inde du Sud »). Document de travail no. 303, Institute of Development Studies (IDS).
Kennard, Matt et Provost, Claire. 2016. « Inside The Corporate Utopias Where Capitalism Rules And Labor Laws Don’t Apply » (« Au cœur des utopies des sociétés où règne le capitalisme et où les lois du travail ne s’appliquent pas »). In These Times, 25 juillet 2016.
Koechlin, Tim. 2013. « The Rich Get Richer: Neoliberalism and Soaring Inequality in the United States » (« Les riches deviennent encore plus riches : néolibéralisme et inégalités croissantes aux Etats-Unis »). Challenge 56 (2) : 5–30. https://doi.org/10.2753/0577-5132560201.
Kölling, Arnd. 2022. « Monopsony Power and the Demand for Low-Skilled Workers » (« Pouvoir de monopsone et demande de travailleurs peu qualifiés »). The Economic and Labour Relations Review 33 (2) : 377–395. https://doi.org/10.1177/10353046211042427.
Madibana, Molatelo Junior ; Fouche, Chris et Manyuela, Freddy. 2024. « Chicken dumping in South Africa and the long-term effects on local commercial chicken farming industry: a review » (« Le dumping de poulets en Afrique du Sud et ses effets à long terme sur l'industrie locale de l'élevage commercial de poulets : une étude »). African Journal of Food, Agriculture, Nutrition and Development 24 (2) : 25559–25577. https://doi.org/10.18697/ajfand.127.23290.
Manning, Alan. 2021. « Monopsony in Labor Markets: A Review » (« Le monopsone sur les marchés du travail : une analyse »). ILR Review 74 (1) : 3–26. https://doi.org/10.1177/0019793920922499.
Mumtaz, Soofia. 2000. « Targeting Women in Micro-Finance Schemes: Objectives and Outcomes » (« Cibler les femmes dans les programmes de microfinance : objectifs et résultats »). The Pakistan Development Review 39 (4) : 877–890.
Naidu, Suresh et Posner, Eric A. 2022. « Labor Monopsony and the Limits of the Law » (« Le monopsone du travail et les limites de la loi »). Journal of Human Resources 57 (7) : S284–S323. https://doi.org/10.3368/jhr.monopsony.0219-10030R1.
Narcisse, Carol. 2010. « Profits fly the Coop: Gender Impacts of Trade Liberalisation on the Jamaican Poultry Industry » (« Les bénéfices s'envolent : les impacts de la libéralisation du commerce sur l'industrie avicole jamaïcaine »). Dans « Trading Stories: Experiences with Gender and Trade », édité par Marilyn Carr et Mariama Williams, 27–40. Londres : Commonwealth Secretariat.
Navarro, Vicente. 2007. « Neoliberalism as a Class Ideology; Or, the Political Causes of the Growth of Inequalities » (« Le néolibéralisme comme idéologie de classe ou les causes politiques de la croissance des inégalités »). International Journal of Health Services 37 (1) : 47–62. https://doi.org/10.2190/AP65-X154-4513-R520.
Noble, Rachel. 2018. « From Rhetoric to Rights: Towards Gender-Just Trade » (« De la rhétorique aux droits : vers un commerce équitable pour les femmes et les hommes »). ActionAid.
Nordås, Hildegunn. 2003. « Is trade liberalization a window of opportunity for women? » (« La libéralisation du commerce est-elle une fenêtre d’opportunité pour les femmes ? »). Document de travail ERSD-2003-03, OMC.
Pearson, Ruth. 2019. « A Feminist Analysis of Neoliberalism and Austerity Policies in the UK » (« Une analyse féministe du néolibéralisme et des politiques d'austérité au Royaume-Uni »). Soundings 71 : 28–39. https://doi.org/10.3898/SOUN.71.02.2019.
Perrons, Diane. 2005. « Gender Mainstreaming and Gender Equality in the New (Market) Economy: An Analysis of Contradictions » (« Intégration de la dimension de genre et égalité de genre dans la nouvelle économie (de marché) : une analyse des contradictions »). Social Politics: International Studies in Gender, State & Society 12 (3) : 389–411. https://doi.org/10.1093/sp/jxi021.
Prügl, Elisabeth. 2017. « Neoliberalism with a Feminist Face: Crafting a New Hegemony at the World Bank » (« Le néolibéralisme à visage féministe : vers une nouvelle hégémonie à la Banque mondiale »). Feminist Economics 23 (1) : 30–53. https://doi.org/10.1080/13545701.2016.1198043.
Rao, Rahul. 2015. « Global Homocapitalism » (« Homocapitalisme mondial »). Radical Philosophy 194 : 38–49.
Réseau interinstitutions pour les femmes et l’égalité des genres. 2011. « Gender Equality & Trade Policy » (« Égalité de genre et politique commerciale »). Document de référence.
Rocha, Nadia et Piermartini, Roberta. 2023. « Trade Drives Gender Equality and Development » (« Le commerce favorise l’égalité de genre et le développement »). FMI.
Tran, Thi Anh-Dao. 2019. « The Feminization of Employment through Export-Led Strategies: Evidence from Viet Nam. » (« Féminisation de l’emploi dans les stratégies axées sur l’exportation : l’exemple du Viet Nam »). Revue de La Régulation 25 (juillet). https://doi.org/10.4000/regulation.14589.
True, Jacqui et Parisi, Laura. 2013. « Gender mainstreaming strategies in international governance » (« Stratégies d’intégration de la dimension de genre dans la gouvernance internationale »). Dans « Feminist Strategies in International Governance », édité par Gülay Caglar, Elisabeth Prügl et Susanne Zwingel, 37–56. Londres : Routledge.
Ukanwa, Irene ; Xiong, Lin et Anderson, Alistair. 2018. « Experiencing Microfinance: Effects on Poor Women Entrepreneurs’ Livelihood Strategies » (« L’expérience de la microfinance : effets sur les stratégies de subsistance des femmes entrepreneures pauvres »). Journal of Small Business and Enterprise Development 25 (3) : 428–446. https://doi.org/10.1108/JSBED-02-2017-0043.
van Elteren, Mel. 2009. « Neoliberalization and Transnational Capitalism in the American Mold » (« Néolibéralisation et capitalisme transnational dans le modèle américain »). Journal of American Studies 43 (2) : 177–197. https://doi.org/10.1017/S0021875809990016.
Western, Mark ; Baxter, Janeen ; Pakulski, Jan ; Tranter, Bruce ; Western, John ; Van Egmond, Marcel ; Chesters, Jenny ; Hosking, Amanda ; O’Flaherty, Martin et Van Gellecum, Yolanda. 2016. « Neoliberalism, Inequality and Politics: The Changing Face of Australia » (« Néolibéralisme, inégalités et politique : le nouveau visage de l'Australie » ). Australian Journal of Social Issues 42 (3) : 401–418. https://doi.org/10.1002/j.1839-4655.2007.tb00066.x.
Williams, Mariama. 2007. « Gender issues in the multilateral trading system » (« Questions de genre dans le système commercial multilatéral »). Dans « The Feminist Economics of Trade », édité par Irene van Staveren, Diane Elson, Caren Grown et Nilufer Çağatay, 277–291. Londres : Routledge.
Williams, Mariama. 2013. « A Perspective on Feminist International Organizing from the Bottom Up: The Case of the ITGN and the WTO » (« Une perspective sur l'organisation féministe internationale de bas en haut : le cas du RIGC et de l'OMC »). Dans « Feminist Strategies in International Governance », édité par Gülay Caglar, Elisabeth Prügl et Susanne Zwingel, 92–108. Londres : Routledge.
Yang, Bin et He, Jun. 2021. « Global Land Grabbing: A Critical Review of Case Studies across the World » (« Accaparement mondial de terres : une analyse critique des études de cas menées dans le monde entier »). Land 10 (3). https://doi.org/10.3390/land10030324.
Produit par Regions Refocus en collaboration avec Nawi – Afrifem Macroeconomics Collective; Institute of Law & Economics (ILE); et l'Asia Pacific Forum on Women, Law and Development (APWLD).
Ce document a été écrit par Erica Levenson (Regions Refocus) avec la contribution de Fatimah Kelleher (Nawi–Afrifem Macroeconomics Collective), Mariama Williams (ILE), Hien Nguyen Thi (APWLD) et Senani Dehigolla (Regions Refocus). Les autrices remercient AWID pour traduire ce document.
Republié par Developing Economics.